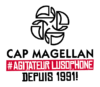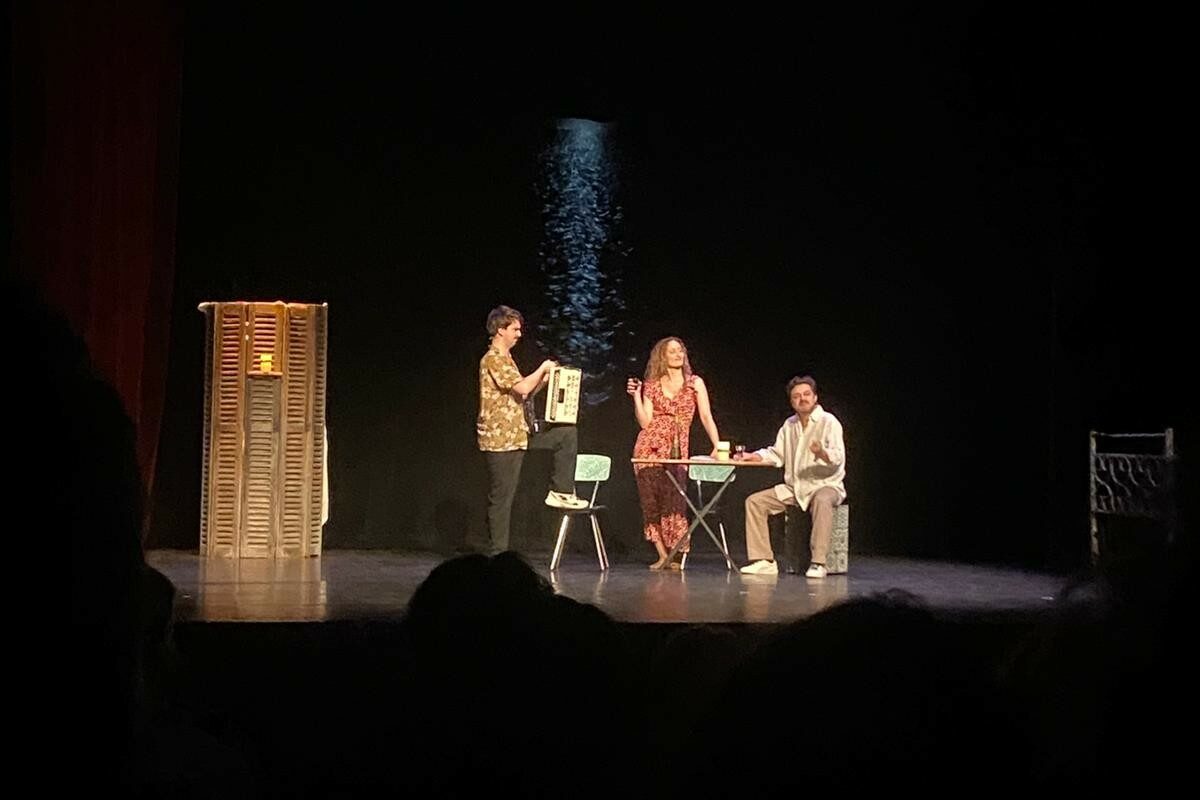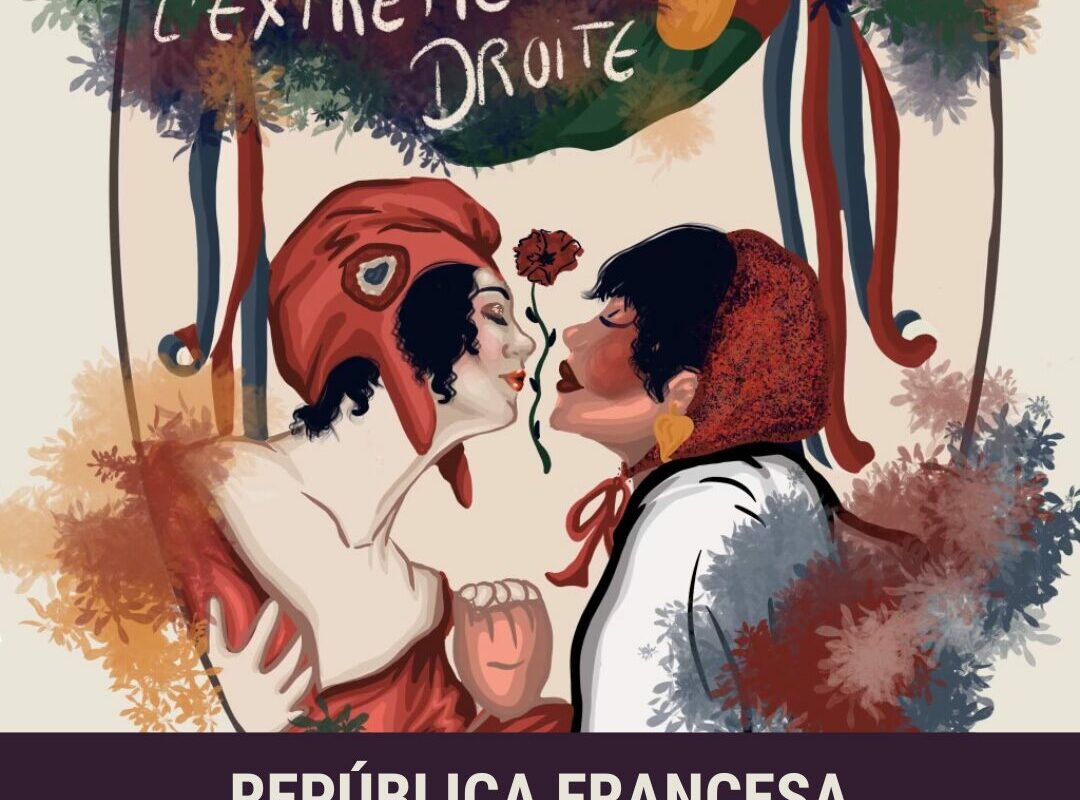Le festival international de choro d’Aix-en-Provence est de retour !
16 avril 2025
Tempestade 2.1 : 4 ans à vos côtés !
24 avril 2025Le 26 mars dernier, Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective, le dernier film de Paulo Carneiro, est sorti dans les salles françaises. A l’occasion de son passage en France, il nous a offert une interview exclusive.
Cap Magellan : Bonjour, Paulo Carneiro. Tu es le réalisateur du film Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective, sorti le 26 mars dernier. Le film raconte l’histoire de la communauté de Covas do Barroso, au nord du Portugal, qui découvre en 2017 qu’une entreprise britannique envisage d’implanter sur ses terres la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d’Europe. Pour protéger la montagne, les habitants décident de faire face et c’est ce que retrace donc ce film. Comment l’idée de faire un film documentaire t’est-elle venue ?
Paulo Carneiro : Ce qui est important c’est de se demander : Comment on pense une fiction ou un documentaire ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Au début, nous avons commencé à aller à Covas do Barroso parce que mon père est d’un village à côté qui s’appelle Bostofrio, où j’ai fait mon premier film. C’est grâce à ce film-là que les gens de là-bas me connaissent. Durant la première de ce film, en 2019, dans les salles de cinéma au Portugal, il y a quelques personnes qui sont venues voir le film et qui venaient me voir pour raconter ce qui se passait là-bas. Je le savais déjà parce que, même s’il n’y avait pas trop d’informations sur la mine, il y avait le bouche à oreille de la région et les gens savaient ce qui se passait.
Au début, nous sommes allés à Covas do Barroso pour faire une espèce de recherche audiovisuelle et pour enregistrer des vidéos avec eux, pour passer le message, divulguer ce que nous avions. Des fois, c’est un peu difficile. C’est un petit village au nord du Portugal, au milieu des montagnes, donc on se demande comment faire pour que les gens des grandes villes se rendent compte de cet événement. Nous avons fait ce travail.
L’idée vient bien après, je pense peut-être huit mois ou une année. Nous étions en train de travailler avec eux, de faire un film à partir de tout ce qu’ils ont vécu, mais en même temps en pensant que ce serait bien qu’ils profitent de faire le film. Nous avons compris que ce serait plus intéressant s’ils étaient disponibles pour faire un western. C’est pour cette raison que le film devient un western un peu musical. Cela sort de l’idée classique du documentaire, c’est également une fiction, un western musical que nous avons construit ensemble. C’était aussi une façon de montrer à travers le cinéma comment lutter contre un ennemi que l’on ne voit jamais. Nous avons profité du fait de tourner un film pour leur faire penser à d’autres choses et pas à la lutte permanente. C’est quelque chose qui n’est pas visible, mais faire un film est une façon de faire face à l’ennemi sans le voir, à travers la caméra, le son, à travers la façon de faire ensemble.
CM : Pourquoi ce projet te tient tant à cœur personnellement ?
Paulo Carneiro : Mon père vient de là-bas. J’ai aussi passé des vacances là-bas, je connais très bien le territoire, je connais d’autres villages. Nous étions enfermés pendant la pandémie et puis je suis allé là-bas et nous avons commencé à filmer. J’ai appris la situation auprès des jeunes avec qui je suis très ami. Je suis aussi dans la lutte d’ailleurs. Quand je commence à réfléchir à mes films, j’essaie de donner la voix aux autres, aux gestes. Mon père a eu une enfance difficile, je viens d’une famille très humble. Les gens peuvent penser que je fais du cinéma militant, mais ce n’est pas mon avis. Je pense que le militantisme dépend de la forme dont on filme. Moi je les filme en étant leur égal, sans être supérieur à eux. En tout cas, la lutte continue au-delà du film, avec des procédures, des papiers, etc. J’essaye d’aider à ma manière.
CM : Comment as-tu réussi à mettre en confiance les habitants, à gagner leur confiance ?
Paulo Carneiro : Ils avaient déjà confiance parce qu’ils ont vu mon tout premier film, Bostofrio. C’est d’ailleurs pour cela que certains sont venus me voir et me parler de la situation. Après, bien sûr, faire un film ce n’est pas facile. On ne fait pas un film tout seul, même si nous étions une très petite équipe. Il y a eu des moments difficiles… Parfois, une nouvelle lutte arrivait : une nouvelle loi, une nouvelle discussion au Parlement ou au gouvernement. Les gens étaient vraiment tristes parce que ce sont des choses réelles, c’est leur vraie vie. Dans ces moments-là, arriver et filmer était difficile. De mon côté, j’essayais de leur dire que nous étions en train de construire quelque chose. J’avais toujours cette idée d’archiviste, de penser que c’est une mémoire de ce temps-là et que cela restera pour toujours. C’était l’idée que ce film était un document de ce par quoi ils étaient en train de passer à ce moment-là, à travers des choses illogiques mais aussi humoristiques. Je les motivais comme ça. Le cinéma a le pouvoir d’enregistrer les gens et les moments et de les garder vivants.
Ils me demandaient beaucoup le temps que cela allait prendre. Ils étaient impatients de voir le résultat final. Je devais leur dire d’attendre, il fallait trouver le bon moment pour avoir une grande sortie ! En mai 2024, nous avons eu une première à Cannes. Ils ont découvert le film à ce moment-là et ont compris pourquoi cela prenait autant de temps.
CM : Pourquoi avoir ajouté les codes du western ?
Paulo Carneiro : C’est surtout un choix humoristique. Cela vient de quelque chose qu’ils étaient en train de préparer donc c’est eux qui sont venus avec cette idée. Il y avait un carnaval et l’idée était de jouer aux cowboys contre les indigènes. Nous avons décidé de les faire jouer, c’était vraiment du cinéma. Ils l’ont fait aussi pour représenter eux-mêmes la lutte. C’est devenu essentiel pour le film.
Quelqu’un lors d’une projection disait que c’était un peu caricatural. Je ne pense pas, c’est avoir la capacité de rire de soi-même malgré la situation. Je pense que pour parler de sujets sérieux, il faut toujours être un peu comique. Cela aide à comprendre les choses et à penser à la vie. La vie est tellement difficile sur plusieurs aspects que si nous restons toujours sérieux, elle perd du sens.
CM : Pourquoi ne pas représenter directement l’ennemi ?
Paulo Carneiro : C’était aussi une option. Dans la vie, nous n’arrivons jamais à parler aux responsables. Nous ne voyons que des secrétaires. Lorsque nous sommes en colère, la personne qui est là pour nous recevoir n’est jamais la personne responsable. C’est pour cela que dans le film on ne voit que le dépliant, le magasin qui arrive, le bureau de l’entreprise ou le travailleur et jamais vraiment l’entreprise ou les travaux. Cela amène la question de faire face à un ennemi invisible. Faire face à cela avec le geste cinématographique, c’était pour moi une façon d’élever le genre du village. Bien sûr il y a les travailleurs, mais ce ne sont pas des ennemis, ce sont des gens qui habitent là-bas, des gens transparents.
CM : Quels ont été les retours des habitants sur le film ?
Paulo Carneiro : Je pense qu’ils sont très fiers du film. Nous avons fait une projection là-bas durant laquelle il y avait un plus grand public qu’à Cannes. Le village compte 150 habitants, mais il y avait au moins 1 500 personnes à la projection ! Il y avait des immigrants, des gens qui sont venus de toute la région pour voir le film.
Je pense qu’il y a beaucoup de discussions dans le village aujourd’hui. Maintenant, il y a des activités culturelles, ils sont en train de faire du théâtre, de la peinture. La lutte a bien grandi, pas uniquement grâce au film, mais aussi à la connaissance de ce qu’il se passe là-bas. C’est bien aussi parce que souvent on pense quand des villages il y a beaucoup de personnes âgées, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont venus y habiter depuis. Cela signifie que le film est sur eux et sur le lien. Je pense que lorsqu’ils regardent le film, c’est ce qu’ils voient. Il n’y pas l’idée de la différence, c’est un film de groupe. C’était important pour moi de faire un film choral.
CM : Est-ce que tu as un mot pour convaincre les gens de venir voir ton film ?
Paulo Carneiro : Espoir.
CM : En 2018 aussi, tu as fondé ta propre société de production qui s’appelle Bam Bam Cinéma. Pourquoi ? Quel en était l’objectif ?
Paulo Carneiro : J’ai compris que pour faire des films comme je veux, il faut vraiment avoir les outils de production et les contrôler. Par exemple, pour sortir les films en France, j’ai négocié le droit du film. Quand tu as le droit et que tu contrôles toute ta production, tu peux plus ou moins faire du cinéma d’une façon que tu contrôles. Je peux par exemple choisir mes équipes et la taille de mes équipes, même si je préfère généralement travailler avec des petites équipes. Je pense que je peux le faire aussi parce que je peux contrôler le budget, les outils et les moyens de production.
J’ai compris également qu’il y avait des jeunes portugais, et pas que puisque j’ai produit aussi des gens de l’Amérique latine et des portugais qui sont dans d’autres pays. J’ai souhaité leur donner la possibilité de travailler pour ceux qui n’arrivaient pas à avoir des producteurs qui croyaient au projet. Je leur permet de discuter le projet, le disputer, profiter de cette possibilité de donner vie à des films qui, quelques mois avant, n’avaient pas leur place dans le marché du cinéma. Avant de penser aux financements et aux budgets, je pense au projet, au film en lui-même et je pense à produire des films que j’aime.
CM : Tu travailles sur ton quatrième long métrage, Ma terre, ma force, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Paulo Carneiro : C’est un film tourné au Cap-Vert. Ce n’est pas sûr le sujet décolonial, c’est sur un groupe de jeunes qui sont en train de reconstruire un village qui a été détruit suite à une éruption de volcan huit ans avant. Ils luttent pour cette terre et pour rester là. Cela s’inscrit un peu contre l’idée que toutes les personnes d’Afrique rêvent d’un jour arriver en Europe ou aux États-Unis. C’est un peu un film contre les contemporains et les idées que la société imprime dans notre tête. Là c’est vraiment un groupe de jeunes qui veut vivre là-bas, y rester et reconstruire leur vie dans ce village. C’est une fiction un peu hybride, parce que le film est basé sur ces vies mais il y a aussi un lien avec le tourisme, surtout français, qui est une façon de gagner leur vie. Bien sûr, il arrive quelque chose à un touriste français qui vient changer le quotidien… Mais je n’en dis pas plus !
CM : Pour finir, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes lusodescendants ?
Paulo Carneiro : Je pense qu’il faut croire tout le temps. Je ne sais pas quoi, mais il faut croire. Il faut avancer et il ne faut pas être immobilisé. Quand je dis croire, je ne parle pas de religion. Il faut croire à ce qu’on est en train de faire et à notre mission ici sur terre.
CM : Merci beaucoup Paulo ! Nous avons déjà hâte de voir ton prochain film.
Nous vous invitons à aller voir Covas do Barroso, chronique d’une lutte collective, disponible dans plusieurs salles en France et au Portugal.
Vous pouvez également suivre Paulo Carneiro sur ses réseaux sociaux : Instagram, site de Bam Bam cinema.
Cette interview est également disponible sur le podcast +351.
Interview réalisée par Camille Vaz Folia
et Julie Carvalho, de Os Cadernos da Julie.
Publié le 18/04/2025